Dans la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), la prédominance du passé et du futur est un concept central. Cela à trait aux ruminations au sujet d’expériences passées (regret, se refaire le « film », etc.), ruminations anxieuses pour notre devenir. Ces rumination nous empêchent d’être connecté au moment présent, de profiter simplement à ce qui est, avec des conséquences sur notre estime de nous-mêmes, notre capacité envers nos relations, sans parler des difficultés d’apprentissages (par manque d’attention, concentration), de fatigue accrue…
Une métaphore pour mieux comprendre :

Imaginez que vous êtes sur un bateau naviguant sur un fleuve. Ce fleuve représente le cours naturel de votre vie, avec son passé derrière vous, son présent actuel et son futur devant vous.
Le passé est comme le courant du fleuve derrière vous. Vous ne pouvez pas changer sa direction ou sa force, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez à ce courant. Parfois, le fleuve peut être agité avec des rapides et des obstacles, représentant les défis et les souffrances que vous avez rencontrés dans votre passé. L’ACT vous invite à accepter la réalité de ce courant, à reconnaître les difficultés passées sans essayer de les changer, mais simplement en les laissant être ce qu’elles sont.
Le futur, quant à lui, est comme le cours du fleuve devant vous. Vous ne pouvez pas voir très loin en raison des méandres et des virages du fleuve, représentant l’incertitude et les possibilités de l’avenir. L’ACT vous encourage à regarder vers l’avant avec curiosité et ouverture plutôt qu’avec crainte ou anticipation anxieuse. Plutôt que de fixer votre regard sur un point précis à l’horizon, l’ACT vous invite à vous concentrer sur le processus de navigation lui-même, en choisissant les actions qui vous rapprochent de ce qui est important pour vous, peu importe les virages que le fleuve pourrait prendre.
Enfin, vous êtes debout sur le pont du bateau, dans le présent, le seul endroit où vous avez un contrôle direct. Vous pouvez sentir le vent sur votre visage, entendre le clapotis de l’eau contre la coque du bateau, et ressentir la stabilité sous vos pieds. C’est dans ce moment présent que vous pouvez exercer votre liberté de choix, en naviguant avec intention et en restant connecté à vos valeurs et à ce qui est vraiment important pour vous.
En résumé, la métaphore du fleuve dans la thérapie ACT illustre l’importance d’accepter le passé, de regarder vers l’avenir avec curiosité et ouverture, et de rester pleinement engagé dans le moment présent.
La Prédominance du Passé et du Futur Conceptualisés en Thérapie ACT
La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) nous invite à explorer la manière dont nous interagissons avec notre passé et notre futur. Plutôt que de chercher à changer ou à effacer nos expériences passées, ou de nous perdre dans des projections futures, l’ACT nous encourage à adopter une perspective différente.
Passé : Acceptation et Perspective
Dans l’ACT, le passé est considéré comme quelque chose d’inévitable. Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons choisir comment nous y réagissons. Plutôt que de lutter contre nos souvenirs douloureux ou nos regrets, l’ACT nous apprend à les accepter pleinement avec sérénité. Cela ne signifie pas que nous devons être d’accord avec tout ce qui s’est passé, mais plutôt que nous apprenons à faire la paix avec notre histoire personnelle. En acceptant nos expériences passées, nous pouvons nous libérer de leur emprise sur notre vie présente.
Futur : Vision et Engagement
D’autre part, l’ACT nous encourage à examiner comment nous envisageons l’avenir. Plutôt que de nous perdre dans des scénarios catastrophiques ou des fantasmes irréalistes, nous sommes invités à nous engager dans des actions alignées avec nos valeurs. L’accent est mis sur la création d’un avenir fondé sur ce qui est vraiment important pour nous, plutôt que sur la peur de l’inconnu ou sur les attentes extérieures. En nous engageant activement et progressivement dans des actions qui reflètent nos valeurs, nous pouvons créer une vie plus riche et plus significative.
L’Importance du Présent : Vivre en Pleine Conscience
Finalement, l’ACT nous ramène régulièrement à l’instant présent. C’est dans le moment présent que nous avons le pouvoir de choisir nos actions et nos réactions. En pratiquant la pleine présence, nous pouvons développer une conscience plus profonde de nos pensées et de nos émotions, ce qui nous permet de faire des choix plus conscients et alignés avec nos valeurs.
En résumé, la prédominance du passé et du futur en thérapie ACT nous invite à accepter pleinement notre histoire personnelle tout en nous engageant activement dans la création d’un avenir aligné sur nos valeurs. En vivant pleinement dans le moment présent, nous pouvons y trouver la liberté d’être véritablement nous-mêmes.



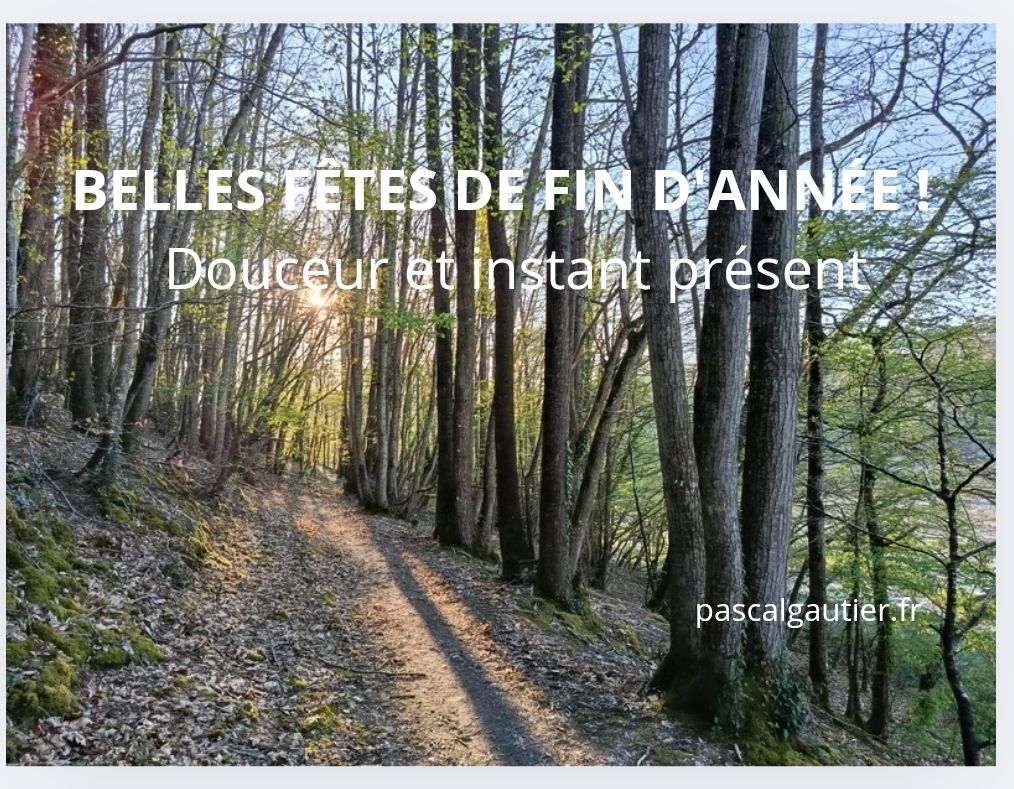
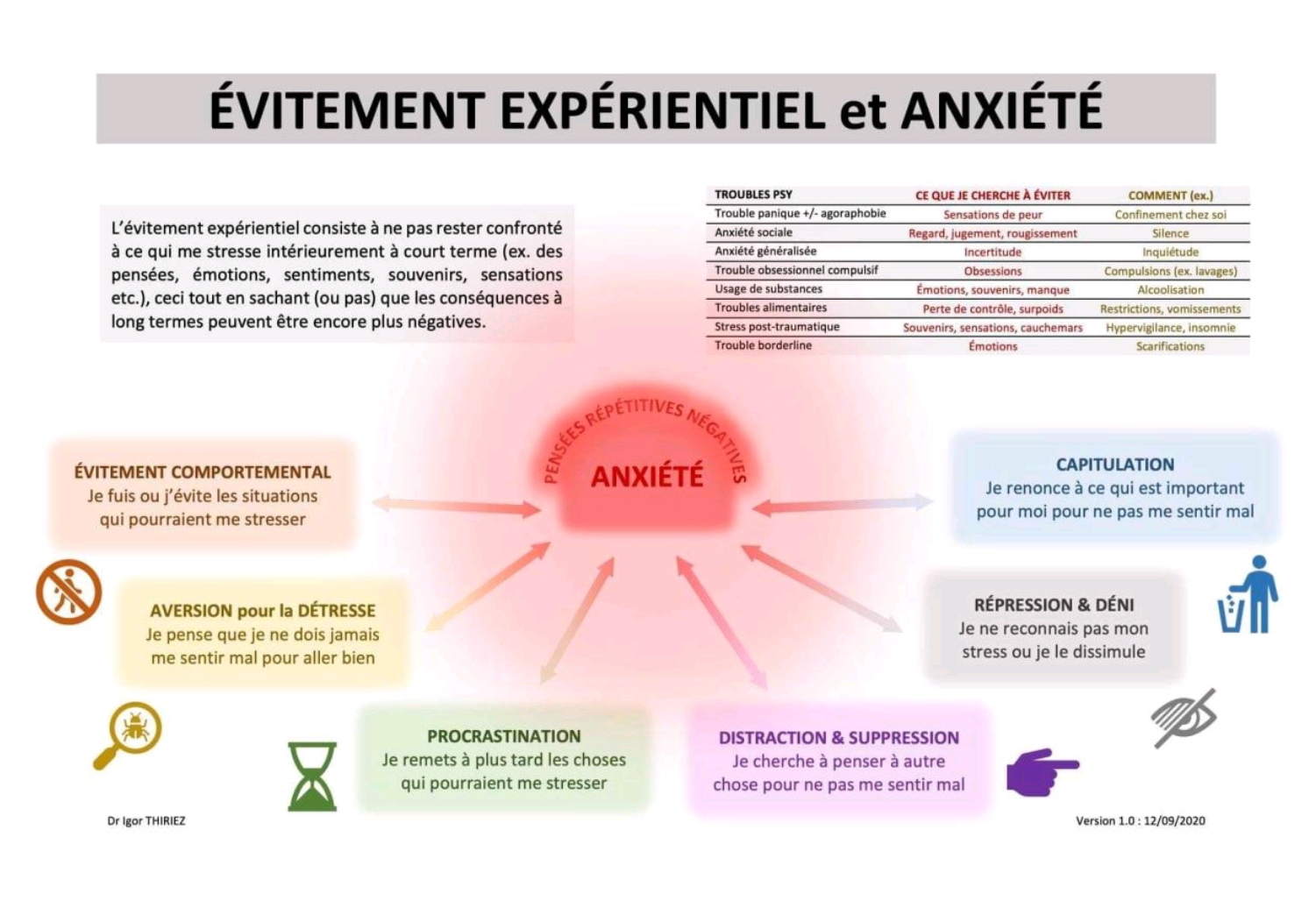
 « Le jour où votre mère meurt, vous souffrez. Si quelqu’un vient vous voir pour exprimer sa tristesse et vous offrir son amitié, son soutien et une main chaleureuse, cela vous réconforte.
« Le jour où votre mère meurt, vous souffrez. Si quelqu’un vient vous voir pour exprimer sa tristesse et vous offrir son amitié, son soutien et une main chaleureuse, cela vous réconforte.