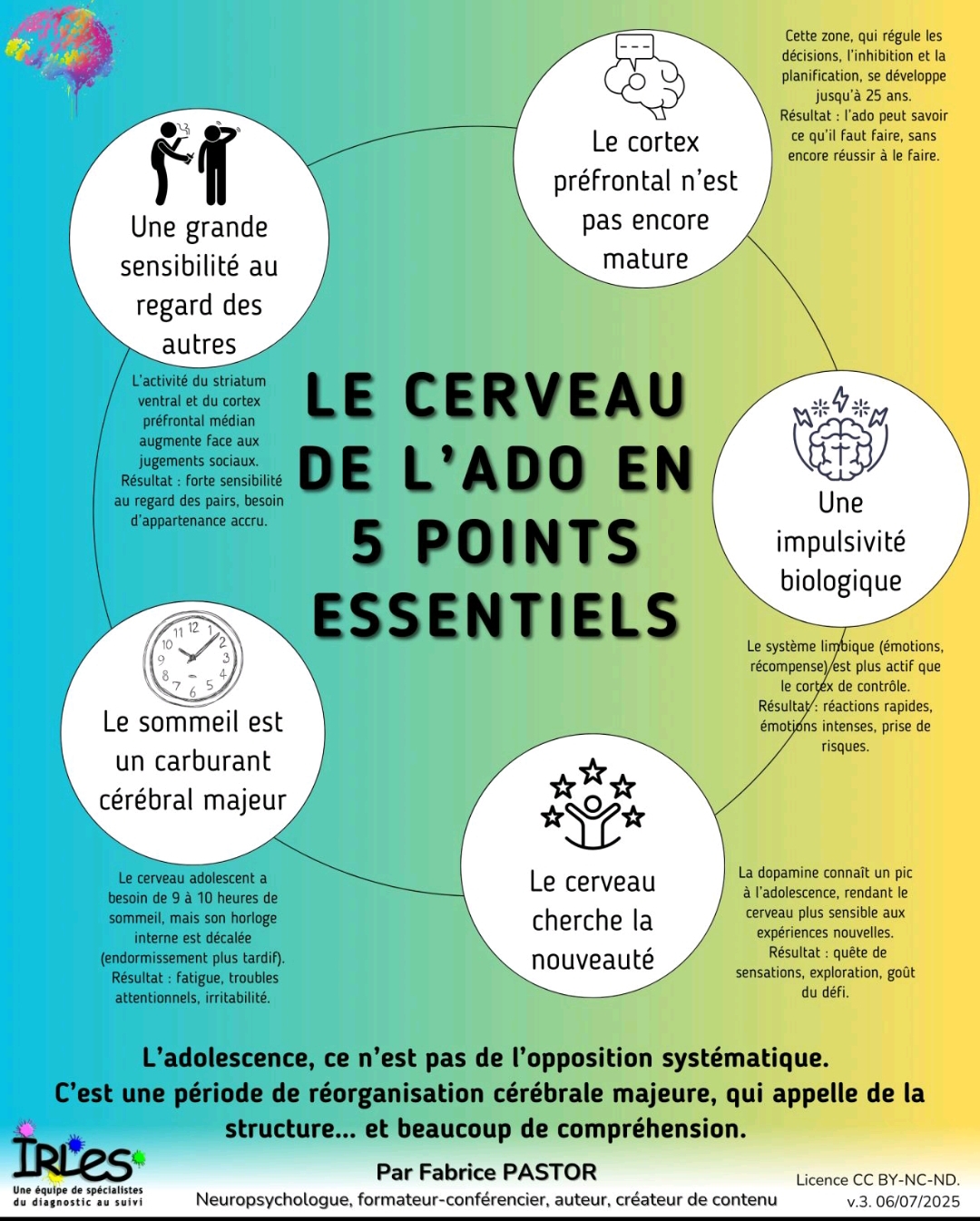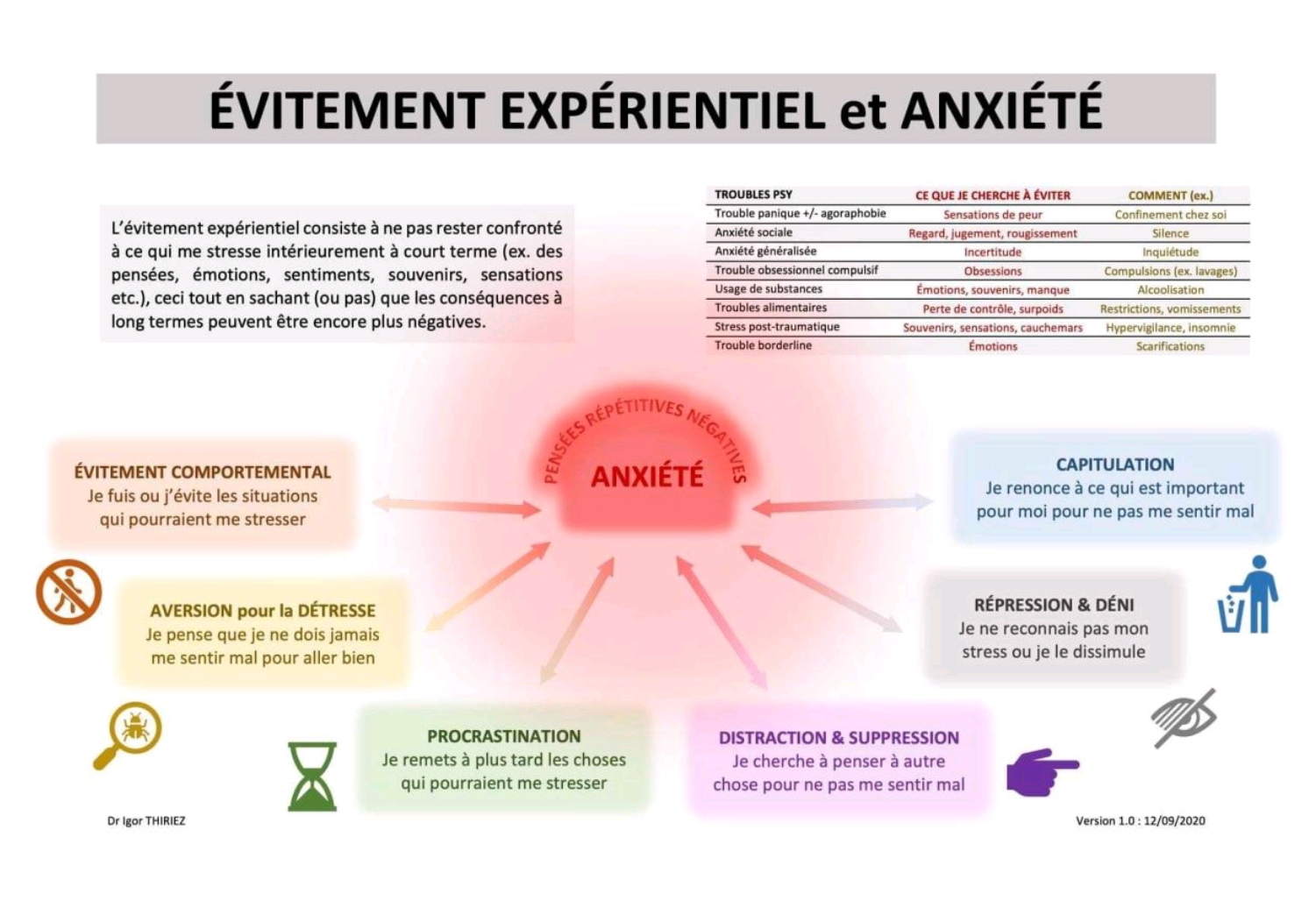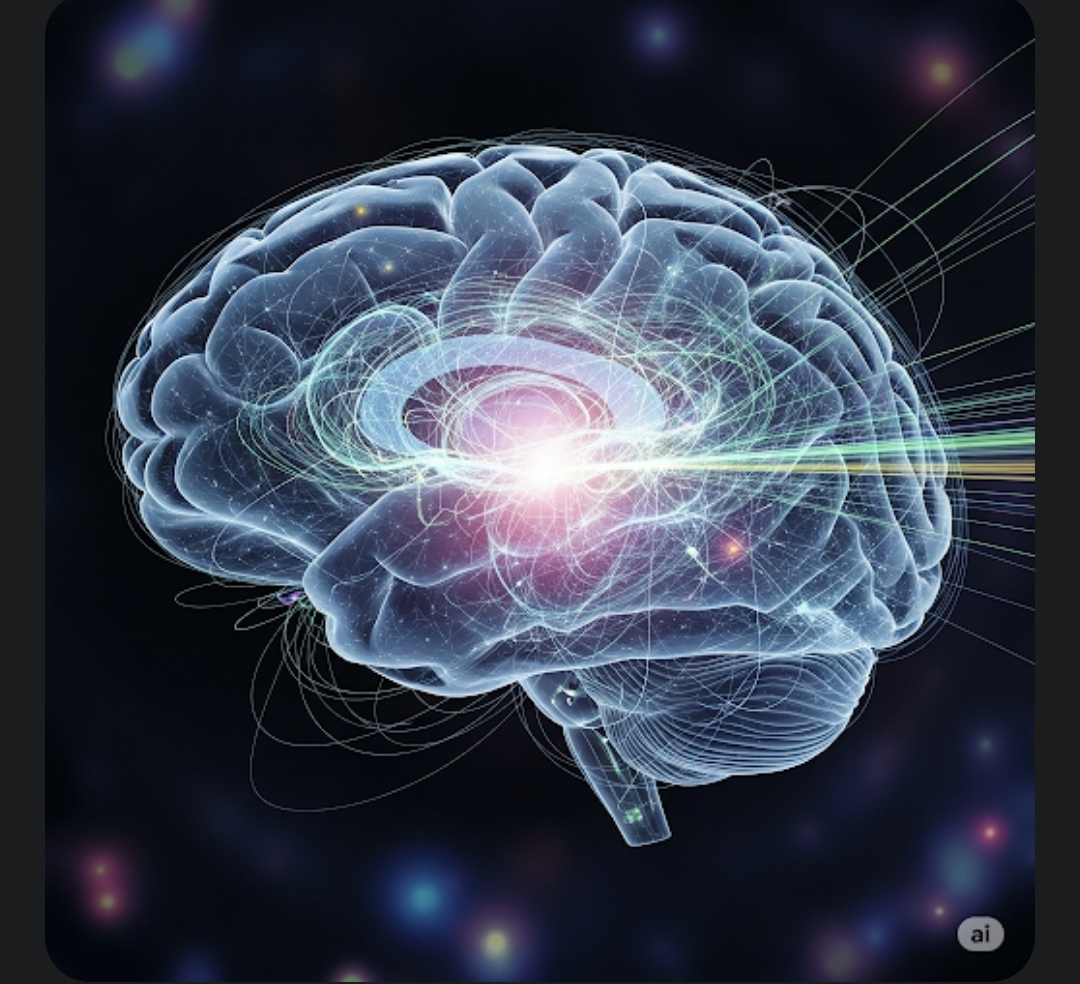
La recherche sur la perception du temps révèle que notre « temps psychologique » ne coïncide pas parfaitement avec le « temps physique », bien qu’il ne soit pas totalement déconnecté. Le projet CHRONOLOGY vise à comprendre comment le cerveau construit une cartographie du temps, posant l’hypothèse que ces mécanismes neuronaux sont communs à différentes espèces.
Des études récentes ont identifié des « neurones temporels » dans le cerveau humain, notamment dans l’hippocampe, essentiels à la mémoire épisodique et à l’organisation temporelle des souvenirs. Ces découvertes suggèrent l’existence d’un système cérébral stable pour représenter le temps, permettant de se projeter dans le passé et le futur et de prendre des décisions. La perception du temps est également influencée par des facteurs émotionnels et physiologiques, le danger ou les émotions intenses pouvant dilater le temps perçu.
Pour aller plus loin : https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/neurosciences/cerveau-comment-ressentons-nous-le-temps/